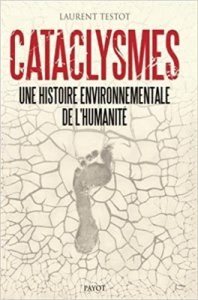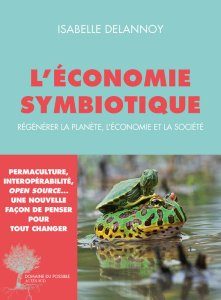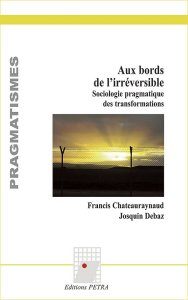La lecture est la chose la plus passionnante que je connaisse. Le plaisir de lire sans objectif particulier réside dans la « sérendipité » (capacité à faire des trouvailles) qui me permet d’avoir des joies inattendues et de relier des connaissances éparses. Je commente peu les livres que je parcours. Avec deux à trois livres par semaine, le blog serait noyé par des résumés de textes. Autant la lecture est rapide autant la note de lecture est un exercice plus long car il faut restituer au mieux la pensée de l’auteur tout en proposant un regard critique. Je viens de faire une longue séquence de lecture.
Je vous propose d’extraire quelques livres qui me paraissent absolument majeurs. Il en manque bien sûr. J’ai dû faire des choix. Je ne suis pas toujours d’accord mais ils me permettent de réfléchir.
Ils m’inspirent un 3+2 =1. Et oui cela peut sembler surprenant, mais cela me semble logique. Nous verrons bien à la fin si je vous ai convaincus.
3 livres grand public. 2 livres plus érudits. Pourquoi 3 ? Parce que le nombre 3 symbolise le reflet du monde naturel dans l’esprit et qu’il faut commencer par des choses simples. On pourrait développer mais ce n’est pas l’objet de ce post. Pourquoi 2 autres ? Parce que ce 2 montre la dualité des choses qu’il faut savoir combiner. J’aime bien la somme 5 qui renvoie à l’homme de Léonard de Vinci mais peut-être aussi au 1 comme le symbole de l’unification. Ces éléments mis bout à bout permettent, il me semble, d’entamer une séquence réflexive.
Cataclysmes. Une brève histoire environnementale de l’humanité de Laurent Testot, Payot 2017
Le livre s’inscrit dans la global history qui est transdisciplinaire. Elle analyse le passé sur la longue durée et les espaces élargis. Elle joue sur les échelles temporelles et spatiales. Ce qui aboutit au paradoxe suivant : ceux qui font aujourd’hui de l’histoire globale en France sont géographes, économistes, philosophes, anthropologues… Mais très rarement historiens.
Le livre est intéressant mais trop systématique dans ses conclusions.
Le livre débute avec l’histoire des singes de Yudanaka qui est une belle allégorie sur l’artificialisation invisible de la nature.
L’auteur évoque une accélération du temps.
– Une Révolution biologique qui se déploie sur 7 millions d’années.
– Une Révolution cognitive qui dura quelques centaines de milliers d’années
– Une Révolution agricole qui prit quelques dizaines de milliers d’années
– Une Révolution morale transforma nos rapports en quelques milliers d’années
– Une Révolution énergétique effectuée en une poignée de siècles
– Une Révolution numérique depuis quelques décennies
– Enfin une Révolution évolutive sur quelques années qui a deux horizons possibles :
– une convergence des techniques pour maîtriser notre environnement.
– Une mutation subie pour s’adapter à la grande altération.
Nous serons Dieux ou mutants en quelque sorte. Une sorte d’écho à Homo deus qui n’aborde que la première piste.
Le livre est conçu comme le film des relations humain-nature. Il part du postulat que l’homme cherche à se nourrir, à dormir et à se reproduire. Il faut accepter le postulat mais gagnerait à être nuancé. De fait le singe (homme) a altéré son milieu mais est aussi issu du climat dès le départ. L’exceptionnalité humaine ne réside pas dans le langage, les outils, la société ou l’organisation mais dans la capacité à exploiter notre environnement par diverses compétences. L’homme engendre perpétuellement le changement sur sa planète et ne cesse aussi de changer lui-même. Il se sert de la nourriture pour nourrir son cerveau et capte pour cela le plus de ressources possibles.
L’homme a développé 3 qualités : être omnivore, imaginatif et coopératif, et plus tard celle d’échanger, d’abord par le troc puis grâce à la monnaie. Cela lui a permis de s’adapter au fil du temps à la terre entière. C’est peut-être l’explication de la disparition des autres hominidés mais cela a conduit à la modification des écosystèmes.
L’empathie fait que nous aidons nos prochains et nous que sommes structurellement spécistes : nous cultivons le « nous » « eux ». Par ailleurs nous n’avons ni repoussé ni exterminé les autres espèces d’hominidés. Nous les avons phagocytées génétiquement.
Il y a déjà eu des extinctions de masse qui s’expliquent par 3 types d’hypothèses : catastrophe, problème de climat ou rôle de l’homme. L’organisation de l’homme est décrite avec de nombreux exemples très riches : hiérarchies dans les sociétés, potlachs, destruction par le feu ici ou là ; domestication des céréales, du riz, de la pomme de terre ; élevage ; adaptation des vêtements ou utilisation du fer, du bronze ou du cuivre, métal malléable.
Des propos durs et discutables émaillent le livre. L’humain est en fait une espèce invasive qui n’a pas de prédateurs et donc prospère dans tous les milieux ; mais fourmille de détails intéressants. La taille des populations est un reflet direct des variations environnementales et des inégalités sociales, voire du type de climat ou de l’organisation agriculture ou chasseur / cueilleur.
Il revient sur quelques inventions cruciales comme l’écriture qui fixe les savoirs et permet d’étendre la transmission. J’ai bien aimé l’allégorie du Mahâbhârata dans la partie religieuse. Le souci de l’autre se heurte au devoir de responsabilité.
J’ai bien aimé l’exemple de la pathocénose. Un organisme vit sur une espèce qu’elle parasite mais quand elle sort d’une limite elle provoque des épidémies. Peut-être comme l’homme avec son environnement. Mais cela me paraît trop systématique. Les réflexions sur la cognition qui nous permet d’imaginer, de raisonner et de se souvenir. La partie sur l’énergie m’était familière. Notamment quand il reprend l’image d’esclave énergétique.
La conclusion est « habituelle ». Nous sommes en train de faire de la Terre un Monde de la Mort bis. La guerre que nous lui livrons nous amène à un point de non-retour. Il faut trouver des solutions ; consommer moins, revoir notre modèle. Mais il faut que l’humanité s’empare du poste de pilotage avant qu’une minorité prétendant représenter ses intérêts n’envoie l’appareil vers un crash définitif. Mais il ne dit pas qui et pourquoi faire.
L’entraide : l’autre loi de la jungle de Pablo Servigne & Gauthier Chapelle, octobre 2017
La présentation de l’éditeur est une parfaite invitation à la lecture. « Dans cette arène impitoyable qu’est la vie, nous sommes tous soumis à la « loi du plus fort », la loi de la jungle. Cette mythologie a fait émerger une société devenue toxique pour notre génération et pour notre planète. Aujourd’hui, les lignes bougent. Un nombre croissant de nouveaux mouvements, auteurs ou modes d’organisation battent en brèche cette vision biaisée du monde et font revivre des mots jugés désuets comme « altruisme », « coopération », « solidarité » ou « bonté ». Notre époque redécouvre avec émerveillement que dans cette fameuse jungle il flotte aussi un entêtant parfum d’entraide… Un examen attentif de l’éventail du vivant révèle que, de tout temps, les humains, les animaux, les plantes, les champignons et les micro-organismes – et même les économistes ! – ont pratiqué l’entraide. Qui plus est, ceux qui survivent le mieux aux conditions difficiles ne sont pas forcément les plus forts, mais ceux qui s’entraident le plus. »
Le rappel initial des travaux de Jean-Marie Pelt, de Jacques Lecomte, de Matthieu Ricard et de Pierre Dardot et Christian Laval (Communs, 2014) plante le décor. Finalement la compétition dans son acception moderne est récente. Et néfaste.
Le terme d’entraide choisi par les auteurs peut prêter le flan à la critique mais ils explicitent parfaitement leur choix. « Ce mot a aujourd’hui l’avantage d’être à la fois bien accepté par le langage courant et suffisamment oublié des sciences pour être à l’abri d’une définition trop étroite. »
En quelques chapitres parfaitement menés, les auteurs nous permettent de nous familiariser avec le fil conducteur de leur livre. D’abord l’entraide (chap 1 et 2), puis le fonctionnement des groupes (chap 3 à 5), enfin une mise en perspective historique qui montre que l’entraide appelle l’entraide (chap 6).
Le chapitre introductif nous narre l’histoire de cet oubli de l’entraide et sa revitalisation dans les études à partir des années 70. J’ai beaucoup aimé l’anecdote du pluvian (un oiseau) et du crocodile d’Hérodote, le rappel des travaux de Kropotkine ou les réflexions sur la « symbiodiversité ». En puisant aux travaux de Michéa, les auteurs donnent une mise en perspective philosophique intéressante.
La partie sur « l’ Entraide » (chap 1 & 2) permet de poser les concepts.
« La tendance à l’entraide spontanée est un trait commun à toutes les sociétés (ce que les anthropologues appellent un trait universel). On serait donc tenté d’y voir un comportement inné, une sorte d’instinct ou de « nature humaine ». »
Concerné par la gémellité, j’ai été amusé par l’étude de David Cesarini, du Massachusetts Institute of Technology (États-Unis). Une fois de plus et comme pour d’autres objets de recherche, les gènes interviendraient pour 10 % à 30 % dans l’expression de certains comportements « coopératifs » ou capacités et l’environnement reste prépondérant (70 % à 90 %). Le rappel des travaux de Kahneman sur les deux systèmes du cerveau est important car ceux-ci sont trop méconnus. Le système 1 est intuitif. Il est caractérisé par une rapidité de réaction, un état d’absence de vigilance, une absence d’effort. Il croit les choses (ou les déduit) sans les avoir démontrées (heurisitiques) ; contrairement au système 2, il ne s’arrête jamais. Le système 2 est fatigant, car il oblige à une concentration totale. C’est une pensée logique, qui demande du temps. Elle oblige à ne faire qu’une chose à la fois. Lorsque le système 1 est mis en défaut, le système 2 se déclenche. La raison se met alors à chercher, calculer, contrôler, se méfier. Mais il convient de débrancher ce système régulièrement, sous peine d’épuisement. Nous sommes tous évidemment enclins à « penser vite », c’est-à-dire à rester en pilote automatique (système 1). La vie est bien plus facile ainsi ! On se met à croire aux idées reçues, on fait des déductions faciles et hâtives, on agit par habitude. C’est par exemple le mécanisme qui convertit un mensonge fréquemment répété en vérité (surtout s’il est répété par des experts, car on a tendance à leur faire confiance, c’est-à-dire à éteindre notre système de remise en question).
Ce double système cognitif offre un cadre cohérent pour comprendre à la fois le côté spontané des comportements et les grandes variations observées. C’est un mécanisme rapide et puissant, mais qui reste toutefois flexible. J’aurais peut-être intégré les travaux de Jonathan Haidt et Craig Joseph, De l’unité des intuitions morales à la diversité des vertus, pour expliquer que l’entraide reste souvent limitée à l’endogroupe et est difficilement universelle.
La partie sur le groupe est passionnante. Elle n’appelle pas pour moi de commentaires particuliers car je suis familier de la psychologie sociale, de la sociologie et de l’anthropologie. J’ai trouvé intéressant de rappeler la règle d’or dans sa version positive et négative. « Traite les autres comme tu voudrais être traité » et « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse. ». Bien sûr le potlach et le don contre don sont abordés. Les auteurs rappellent que l’empathie passe par 3 stades qui sont l’empathie affective, l’empathie cognitive et la combinaison des deux, appelée « empathie mature ». On y aborde le rôle des institutions et de nombreux autres concepts. J’ai trouvé utile de rappeler un certain nombre d’études connues plutôt par les spécialistes. Les travaux de F. de Waal, de S. Tisseron ou de Haidt. Ceux de Pickett et Wilkinson sur les inégalités. Ceux de E. Fehr et U. Fischbacher sur l’altruisme humain ou ceux d’Ostrom sur les communs. J’aurais peut-être développé plus ceux d’Axelrod sur la survie dans un monde d’égoïstes, qui est un classique.
Je voudrais conclure l’exploration du livre par le passage sur l’entraide qui appelle l’entraide dans le dernier chapitre. En effet « l’entraide crée de nouvelles opportunités d’entraide. » et les auteurs de développer la thèse qui fait je crois le fil conducteur du livre : « Ce principe a fait émerger deux propriétés remarquables du vivant. Premièrement, la symbiodiversité a naturellement tendance à augmenter et à former un inextricable emboîtement d’interactions à tous les niveaux (nous l’avons vu au chapitre 1 : l’être humain comme produit de cinq associations majeures), c’est-à-dire une toile du vivant multicolore. Résultat ? Après presque 4 milliards d’années d’évolution (et donc d’innovations), chaque organisme vivant sur terre est potentiellement en interaction mutuellement bénéfique avec un ou plusieurs autres organismes. Deuxièmement, cette interdépendance radicale de tous les êtres renforce clairement la résilience des systèmes vivants. Si la forêt fonctionnait principalement sur le mode de la compétition, chaque arbre tenterait de faire le vide autour de lui, et nous aboutirions vite à une collection d’individus isolés et séparés les uns des autres, bien vulnérables à la première tempête ou sécheresse venue (et cela ne ressemblerait plus guère à une forêt). Mais un individu ou une espèce qui tue ou épuise ses voisins finit par se retrouver seul(e) et par mourir. N’est-ce pas la voie que l’espèce humaine a décidé de prendre ? Nous programmons méticuleusement notre future solitude dans une illusion d’« indépendance ». En fait, nous creusons tout simplement notre tombe. » Une belle méditation. Mathieu Ricard abondamment cité nous y invite.
L’économie symbiotique. Régénérer la planète, l’économie, la société d’Isabelle Delannoy, Acte sud 2017
La transition est parfaite entre les deux livres. Puisque nous venons de (re)découvrir l’entraide, poussons la logique plus loin. Celle qui verrait proposer une théorie économique radicalement nouvelle : l’économie symbiotique, capable de faire vivre en harmonie les êtres humains et les écosystèmes.
Isabelle Delannoy propose une synthèse entre de nombreuses techniques et recherches mises en lumière ces dernières années : permaculture, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, du partage – pair à pair –, économie sociale et solidaire, monnaies complémentaires… Il y avait bien eu le livre de Rob Hopkins, Il change le monde, 1001 initiatives de transition écologique, mais il n’avait pas le caractère systématique de cet opus.
L’énorme avancée du livre tient dans les quelques lignes fondamentales qui suivent :
« Cette nouvelle économie est radicalement différente de l’actuelle. Elle peut être décrite par six principes (que j’appellerai dans cet ouvrage les “principes symbiotiques”) qui sont à l’origine des plus-values produites par ces nouveaux modèles. Ils reposent sur :
– une collaboration libre et directe entre entités ;
– une diversité d’acteurs et de ressources qui respectent l’intégrité de chaque entité ;
– des territoires de flux communs, accessibles à tous de façon égale ; ce sont des territoires matériels où circulent les ressources, mais aussi immatériels où se croisent les intérêts et les valeurs ;
– l’utilisation prioritaire des services rendus par les écosystèmes ;
– la recherche de l’efficience maximale dans l’utilisation des ressources, qu’elles soient de la matière,
de l’énergie, ou de l’information ;
– la recherche de l’inscription des activités humaines dans les grands cycles de la planète préservant son équilibre écologique global.
Nous les retrouvons dans la conduite des écosystèmes vivants, des écosystèmes industriels et des écosystèmes sociaux. Ils s’appliquent à la production, à la consommation et aux modes de gouvernance y compris de redistribution de la valeur. Ils forment une nouvelle logique économique. Lorsque ces six principes sont respectés dans l’ensemble de ces dimensions alors les ressources entrent en symbiose. »
Ces principes sont parfaitement cohérents et articulés correctement, ils peuvent constituer une économie efficiente. L’auteure développe quatre axes : la gestion des ressources, les modes de développement, les échanges économiques et les nouvelles formes d’organisation de la cité qu’elles sous-tendent. Elle s’efforce d’exposer les bénéfices, les limites, les dangers et les possibilités de sa théorie. C’est une lecture très stimulante comme les deux premiers livres.
Le constat initial est celui d’une économie actuelle inefficace qui détruit nos écosystèmes. Le premier chapitre est consacré au rôle de l’information. J’ai pris plaisir à retrouver la notion de noosphère de Teilhard de Chardin. De nombreux exemples de réussites éparses se structurent sous nos yeux en un schéma cohérent si l’homme catalyse les écosystèmes vivants en multipliant leur efficience naturelle. Elle insiste donc sur le partage et la distribution d’informations. En effet, des trois types d’écosystèmes que met en lien l’économie symbiotique – vivants, humains et industriels –, deux sont ainsi basés sur l’information : le vivant et l’humain. Il faut donc les coordonner par l’information. La distinction entre mutualise et symbiose est importante à comprendre et est clairement expliquée. On sent un tropisme important pour l’univers du logiciel libre ou celui des fablabs mais cela ne nuit pas au propos. Pour amorcer son processus il faut réanimer les ressorts de la terre (chap 2). Nous pouvons bâtir la richesse de nos territoires, créer nos emplois, régénérer nos paysages et nos vies à partir de nos sols. Pour cela il convient de changer d’agriculture et promouvoir la permaculture ou l’agroforesterie. Reprenant Sepp Holzer elle nous invite à mettre en synergie les espèces et les écosystèmes en promouvant systématiquement l’entraide et le partage des connaissances comme R. Sass Fergusson et S. Taylor Lovell ont pu l’étudier. Cela fonctionne très bien sur des boucles locales ou pour l’agriculture en ville. Elle propose d’ailleurs d’étendre la logique à l’urbanisme, à la gestion de l’eau et à notre environnement en interconnectant les différents espaces. Un long développement sur le biomimétisme de Benyus est le bienvenu. Il permet d’éviter l’écueil d’Idriss Aberkane qui sépare l’homme de la nature. Les chapitres suivants nous invitent à comprendre le lien entre l’énergie et la matière. A réinventer l’industrie en s’inspirant du modèle de Kalundborg. Il y a des références passionnantes comme Maximilien Quivrin, André-Yves Portnoff, Pierre Giorgini ou Elenore Smith Bowen par exemple, et d’autres plus classiques comme Tim Jackson. J’aime beaucoup la conclusion de sa ville symbiotique (du futur ?). Installée la-bas, « les productions se sont spécialisées à mesure. Autour de la ville sont apparus aussi des ateliers de plus grande dimension pour les machines les plus coûteuses. Les investissements ont été mutualisés avec les autres communes du territoire. Ces formes de commerce sont nouvelles : elles favorisent l’investissement coopératif et se marient à la transmission : on peut y acheter comme y apprendre à produire. Nous avons des conserveries et des légumeries qui fournissent en plats préparés, et des pharmaciens, en préparations médicinales personnalisées. Nous avons aussi notre “maison des voisins” : on y fait la fête, on s’y réunit, on y a nos cours de yoga, de peinture, de musique. » Pour le yoga, j’aurais du mal, c’est trop calme pour moi. Bien sûr j’ai quelques remarques. Je trouve qu’il y a beaucoup de références au monde du libre (informatique) et notamment les analogies. Je n’ai pas trouvé la notion de capacité porteuse (j’ai fait une recherche plein texte, le concept n’est pas utilisé) qui me semble importante pour jauger de la soutenabilité forte d’un système. Donc le nombre d’individus qui s’intégreront dans cette logique. Comme pour Tim Jackson, je n’arrive pas à voir un chemin pacifique vers ce modèle, sauf si la coopération promue dans le livre précédent retrouve ses lettres de noblesse. J’ai des réserves quand on dit qu’il ne faut pas avoir peur de notre puissance. Des vieux réflexes éthiques. Je trouve globalement que la notion de gouvernance et les questions d’énergie en général doivent être approfondies.
Mais le très positif domine et cela me donne un bon prétexte pour passer aux deux ouvrages suivants. Ils s’adressent plutôt à des spécialistes. J’en ferai une présentation plus courte. Mais ils sont importants pour comprendre les enjeux et les jeux de pouvoir.
Aux bords de l’irréversible. Sociologie pragmatique des transformations de Francis Chateauraynaud et Josquin Debaz, Petra 2017
Pour les sociologues ce livre me paraît remarquable. Un très bon résumé en a été fait par Florian Forestier dans Futuribles. Le coeur de l’ouvrage réside selon moi dans cette citation de la page 125 : « On retrouve ici ce que dit Marcelo Dascal de la controverse, dans laquelle il voit une figure instable entre la discussion (orientée vers la coopération) et la dispute (de nature agnostique). La controverse peut conduire vers la coopération, l’accord ou le consensus ou au contraire vers le dissensus, le désaccord, le différend. […] Lorsque l’argumentation évolue plutôt vers la séparation des perspectives que vers leur conciliation, la controverse a au moins pour vertu de clarifier les attachements, les valeurs, les formes de raisonnement. C’est ce qui permet de voir dans certaines controverses des conflits réussis. »
Les auteurs nous invitent à la controverse pour avancer et à questionner les formes d’expertises qui peuvent être en opposition, en collectif, en distribution ou dialogique.
La première partie critique les modèles globaux des prédicateurs de l’anthropocène et montre en quoi une approche pragmatique est nécessaire car elle pose la question du pouvoir. « Qui a le pouvoir de définir les priorités absolues, les problématiques légitimes et tant qu’à faire le bon rapport à l’action ? ». Ils s’attachent à montrer la difficile hiérarchisation des risques en étudiant divers programmes et rapports (PNUE, AEE, ANSES, etc.) et montrent l’impact des éthiques de responsabilité sur les inégalités environnementales. Les risques globaux génèrent de l’incertitude. La scénarisation des futurs est un problème épineux. Le tableau de la p.168 est un formidable outil pour penser urgence, attente, anticipation, prévision, prospective, promesse, prophétie et science-fiction. Très utile quand on parle du futur.
La deuxième partie est consacrée à la socio-ballistique des processus complexes. En français normal, cela signifie tenir compte du contexte socio-historique de chaque dispute ou controverse pour en retrouver la trajectoire (balistique), les acteurs et les points d’évolution dans la compréhension. Il montre l’intérêt de la casuistique, c’est-à-dire l’étude des cas. Ils montrent que la multiplication des objets d’alerte (le plus urgent pour chaque porteur) et des canaux d’information (web, réseaux sociaux, etc.) nécessite une prise de recul que permet la sociologie pragmatique. Elle nous dévoile à travers des exemples comme le Médiator ou l’amiante le conflit d’intérêts permanent et les problématiques d’emprise et de déprise sur des sujets. Cette partie est très féconde pour se constituer des outils intellectuels pour comprendre le pouvoir et les luttes d’influence dans des technosciences en conflits.
La troisième partie s’attache à comprendre l’origine des signaux d’alerte susceptibles de conduire à des ruptures importantes dans la façon de traiter certaines questions. Les apports autour de l’émotion, de la perception et de la vigilance sont indéniables. Le travail sur la pollution à Bagnolet par exemple et l’apparition disparition au fil du temps est remarquable. Et de s’apercevoir qu’un problème doit avoir un statut public pour exister.
Il s’agit enfin, dans la dernière partie, de redire la défiance pour les théories générales. « Si la pensée politique se plaît à germer sur des oppositions simples et binaires, toute théorie générale en science sociale contribue en raison de sa performativité propre, à la formation de catégories publiques et rares sont les catégories qui ne sont pas vouées à une forme ou l’autre d’essentialisation. En vertu de quoi un usage, raisonnable, de procédés de relativisation est toujours salutaire en ce domaine. »
Et de se méfier des discours dominants. Mais la pragmatique de l’action permet de montrer les sept péchés du capitalisme et de porter une nouvelle modalité de passage de la turbulence à l’action. J’ai retrouvé l’esprit des communs (2014) de Pierre Dardot et Christian Laval. Et la critique des sept péchés du capitalisme était évocatrice. La notion d’arène du silence m’a beaucoup séduit.
Manifeste pour une géographie environnementale. Géographie, écologie et politique. Denis Chartier, Estienne Rodary (dir.) Presse Science Po, 2016
Cet ouvrage collectif s’apparente à un plaidoyer écrit par des géographes, majoritairement français, et rassemble toute une série de réflexions qui ont pour ambition de construire les bases communes d’un rapprochement entre l’écologie, la politique et la géographie. Il vient en écho à l’ouvrage précédent.
Organisé en trois parties, il développe une réflexion épistémologique (étude critique des sciences et de la connaissance scientifique). Le texte prend appui sur l’histoire de la géographie et étudie ses relations aux autres disciplines et au monde politique, dans un contexte où la question proprement politique que pose l’environnement à notre rapport au monde n’est pas encore consolidée de manière satisfaisante. Le constat est clair : la géographie française n’examine pas assez les ramifications socio-politiques des processus environnementaux en mettant en avant les systèmes d’organisation sociale qui les sous-tendent. Cette frilosité tranche avec la Political Ecology institutionnalisée dans le corps académique, notamment aux États-Unis dans les départements de géographie. On redit les difficultés d’une mise en dialogue des sciences sociales et des sociétés. On indique les difficultés de pouvoir et les questions de l’expertise. Il manque cependant peut-être une partie sur l’Urban political Ecology qui constitue une branche prometteuse de réflexion en alimentant beaucoup d’études discutant des inégalités sociales par rapport à l’accès aux ressources environnementales en ville et aux aménités urbaines, tous en les mettant en relation avec les théories du capitalisme et de la globalisation néolibérale. Des axes de réflexion infléchir le cours des choses.
Nous n’avons pas de planète de rechange. Il faut l’habiter au mieux. Ces quelques ouvrages nous y invitent comme l’encyclique Laudate Si dans un autre registre.
3+2 =5 =1.